Encore affecté par le départ du Major, Batou, enquêteur spécial de la Section 9 va devoir collaborer avec Togusa afin de résoudre une énigmatique série de meurtres.
Les années quatre-vingt-dix ont constitué un tournant majeur pour l’animation japonaise, jusque là décriée à tort, par l’intelligentsia occidentale. Plusieurs auteurs se sont ainsi engouffrés dans le sillage de Katsuhiro Otomo et de son Akira, acclamé à cor et à cri dans le monde. Parmi eux on retrouve bien entendu Hayao Miyazaki, Isao Takahata ainsi que Mamoru Oshii et Satoshi Kon. Ces deux derniers partagent la particularité d’utiliser le genre pour s’apparenter davantage au cinéma traditionnel afin de transcender leur art.
Voilà pourquoi James Cameron n’a eu de cesse d’encenser Patlabor 2, Ghost in the Shell puis l’essai en prises de vues réelles de Mamoru Oshii, Avalon. Le metteur en scène a redéfini l’approche de la science-fiction et a inspiré bon nombre de ses pairs par la suite, à commencer par les sœurs Wachowsky. Et ce n’est donc point étonnant que son second segment dédié à Ghost in the Shell, baptisé Innocence, ait été sélectionné pour le Festival de Cannes en 2004, tant il fait figure de ponte, en dépit d’un accueil public plus réservé (il peine à l’attirer en salles).

On se demande alors si la Croisette consacrera le Nippon comme le fit Berlin qui récompensa Miyazaki avec l’Ours d’or pour Le Voyage de Chihiro deux ans auparavant. Présidé par Quentin Tarantino cette année-là (pour qui le studio d’Oshii réalisera la partie animée de Kill Bill), le jury du Festival de Cannes boudera Innocence. Une honte ? Oui et non, puisque s’il est légitime désormais de reconnaître le statut culte du long-métrage (voire de le considérer en tant qu’authentique chef-d’œuvre). Innocence déconcerte trop par sa démarche verbeuse, hautement élitiste qui laisse trop souvent le spectateur sur le côté de la route.
Néanmoins, dès que l’on prête attention aux intentions d’Oshii, on découvre un objet fascinant, d’une richesse rarement égalée depuis, à l’écriture ciselée, qui se réapproprie tout le travail passé du metteur en scène (méta avant l’heure ?) tout en offrant une réflexion sans concession sur notre environnement présent et à venir. Et bien que son fidèle compagnon et scénariste, Kazuniro Ito ne fasse pas partie de l’aventure, Oshii délivrera une leçon d’anticipation hors norme.

Ève lève-toi
Selon certaines rumeurs, Stanley Kubrick aurait renoncé à son projet de film autour de l’intelligence artificielle après avoir vu le premier Ghost in the Shell. Il faut avouer que l’adaptation du manga éponyme de Masamune Shirow avait impressionné l’ensemble de la profession et des critiques, au point de devenir le successeur légitime du Blade Runner de Ridley Scott. Son traitement de la question de l’humanité, sa façon d’envisager que des êtres composés de peu de chair et de beaucoup de métal puissent posséder une conscience, voire une âme, intriguait et fascinait.
Avec Innocence, Oshii pousse sont étude au-delà du possible, en s’appuyant sur le roman de Villiers de L’Isle-Adam, L’Ève future, considérée comme l’un des premiers récits de science-fiction de l’Histoire de la littérature, qui narrait la relation entre un Lord anglais et une femme mécanique, conçue de toute pièce par Thomas Edison. Cette œuvre déstabilisa par son fond et sa forme à l’époque, et a sans doute influencé Fritz Lang et son androïde de Metropolis. Quoi qu’il en soit, il n’est point étonnant que le réalisateur ait puisé l’essence de son projet dans l’ouvrage francophone, tant il admire la culture européenne (il vénère notamment Ingmar Bergman).
Par ce biais, il déploie une mécanique aussi complexe que celle qui élabore les cyborgs de son univers afin de relier une fois encore l’organique et l’acier, le ghost (équivalent de l’âme et de l’instinct) et l’artificiel, tout en s’interrogeant sur les bases qui définissent l’individu. Quand on le démembre ou qu’on le modifie à l’extrême, qu’en reste-t-il ? En opposant ses cyborgs à des poupées douées elles-mêmes d’une âme par un procédé machiavélique, Oshii répond par des sous-entendus et des remarques tantôt pertinentes, tantôt osées. La conversation avec la légiste en surprendra plus d’un, surtout lorsqu’elle associe la maternité avec le lien ambigu entretenu entre une fillette et sa poupée.

Abscons ou ambitieux ?
D’ailleurs ce fameux dialogue souligne à la fois toute la force, mais aussi tout ce que l’on reproche à Innocence. L’aspiration démesurée affichée par Mamoru Oshii se conjugue à un discours prolixe et surtout cryptique pour un large public. Et il est vrai que l’on pourrait juger son dispositif prétentieux. Néanmoins, il rappelle par instants l’excellence exigée par des auteurs de la trempe de Stanley Kubrick, dont le 2001 est souvent considéré comme inaccessible, à tort ou à raison.
Quoi qu’il en soit, personne ne contredira la densité du script et la recherche incessante du mot juste, au service d’une entreprise philosophique de haute volée. Ici, alors que la poésie est retranscrite par de longs silences ou des moments d’une infinie contemplation qui s’étirent, la vérité se transmet par le biais de messages sibyllins, se référant à d’antiques érudits ou au savoir religieux. Le réalisateur a recours à de multiples citations de Confucius, utilisées à chaque fois à bon escient ou à un symbolisme biblique renvoyant à la Genèse, justifiant comment la création de l’homme et de la femme ne signifie plus rien dans une ère technologique.
La science prévaut comme l’explique l’extrait de L’Ève future de l’introduction et l’avènement d’un monde nouveau se profile à l’horizon. Ne reste plus alors comme vestiges de la civilisation d’antan, l’affection pour un animal de compagnie dupliqué (vous avez dit Blade Runner ?) ou le défilé d’un carnaval vénitien durant lequel, les chiens aboient de concert. Autant d’images mystiques qui imprègnent la rétine et définissent le caractère mystérieux de ce long-métrage.

Amalgame d’un art
L’autre grand trait qui définit Innocence réside dans l’adoption d’une formule syncrétique visant à rassembler toutes les tendances de la filmographie d’Oshii. Si cette option est depuis à l’ordre du jour pour bon nombre de productions, la manière dont le cinéaste se l’approprie se pare d’une incontestable élégance. Certes, il y a les clins d’œil prononcés à Avalon, mais ceux-ci s’insèrent naturellement à l’ensemble.
De la scène durant laquelle Batou prépare affectueusement un repas pour son chien tel Ash ou du plan final avec le regard fixe d’une fillette, invitant au voyage, Oshii reprend certains éléments de son précédent long-métrage mais pas que… il s’attarde surtout sur le passage du labyrinthe mental au sein duquel Batou et Togusa sont piégés, morceau de bravoure énigmatique qui renvoie à celui de Beautiful Dreamer. La boucle temporelle, chère à Harold Ramis avait été en effet employée deux ans Un jour sans fin par le réalisateur japonais lors de son direct to video relié à la série d’animation Lamu.

Désormais, il s’en sert pour entretenir la paranoïa, une thématique récurrente dans son œuvre, qui s’empare des uns et des autres et fait vaciller leurs certitudes. Avide des trames politiques complexes, Oshii apprécie l’atmosphère des récits d’espionnage et diffuse leur essence dans ses thrillers oppressants, à l’ambiance de fin du monde. Chacun doit déjouer des complots d’envergure s’il désire survivre et lever les voiles illusoires qui trompent les sens.
On se souvient ainsi des attaques fallacieuses de Patlabor 2, du faux assaut aérien au gaz inoffensif, semant la panique sur son passage ou de ce terroriste de fortune, abusé par un pirate informatique dans Ghost in the Shell, dont la famille a été inventée de toutes pièces (d’ailleurs Batou évoque le sujet avec Togusa en dressant un constat parallèle avec la situation de son coéquipier). Dans Innocence, la psychose culmine lorsque Batou, pris d’un accès de folie incompréhensible (ou plutôt induit par un autre) vide le chargeur de son pistolet dans son propre bras, pendant qu’il effectue ses courses. Dantesque.
La fille en question
Et au-delà de toutes ces considérations métaphysiques ou politiques, Oshii n’omet jamais de revenir aux sources de son projet, à sa propre nature, celle née du film noir, à l’instar de Blade Runner. Tandis que Batou se démène durant ses investigations, une ombre plane, celle d’une femme qu’il a chérie jadis, omniprésente dans le réseau, mais jamais physiquement, ou uniquement à travers un autre corps que le sien. Il pense à elle, même s’il se refuse à l’admettre tout en écartant un partenaire qu’il n’acceptera jamais réellement.
La question de l’existence se pose de nouveau tandis que ce cyborg, incapable d’avouer ses sentiments, espère et attend un retour hypothétique. On comprend alors que l’amour franchit les barrières de la chair quand Makoto projette son esprit à l’intérieur d’un des androïdes, durant une conclusion haletante. Quelques minutes d’éternité pendant lesquelles les retrouvailles s’opèrent au son du sifflement des balles, tandis que les coups pleuvent et que la mort rôde… une séquence homérique magnifiée par la chorégraphie orchestrée par Oshii et son équipe.
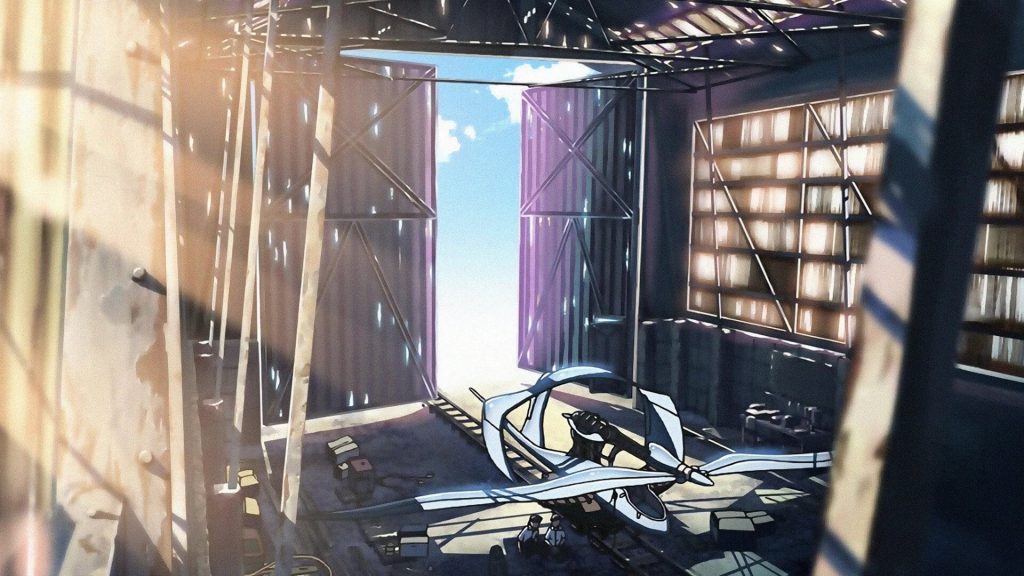
Le metteur en scène l’ignore à cette époque, mais Innocence marquera l’apogée de sa carrière et constituera quelque par la quintessence de sa filmographie. Si Sky Crawlers possède quelques relents de son génie, ce qu’il produira par la suite se révélera vain (hormis le clip Je t’aime). Triste pour cet artiste de tomber peu à peu dans l’oubli, lui qui aura inspiré énormément la génération suivante.
Film d’animation japonais de Mamoru Oshii avec les voix originales de Akio Otsuka, Koichi Yamadera, Atsuko Tanaka. Durée 1h40. 2004
François Verstraete
Share this content:

