Le quotidien de jeunes internes dans un hôpital de la région parisienne avec son lot de joies et surtout de drames.
En 2014, Thomas Lilti, lui-même ancien médecin, s’était distingué avec un premier long-métrage, Hippocrate, qui retranscrivait les péripéties d’un jeune interne, confronté aux affres de l’activité hospitalière. Si le tandem Vincent Lacoste Reda Kateb faisait mouche, l’expérience passée du cinéaste crédibilisait davantage son entreprise et lui insufflait le soupçon de vécu indispensable. Fort de ce succès, il continua par la suite à s’intéresser à son précédent milieu, à travers des films tels que Première Année ou Médecin de Campagne… des travaux qui ne l’ont jamais éloigné de son premier bébé.
En effet, en 2018, il lance une série télévisée sur Canal Plus, Hippocrate, sorte de spin-off de son long-métrage éponyme, mettant en scène, une fois encore une équipe de soignants, parfois en formation, en prise avec un système au bord de l’implosion. Depuis, Hippocrate a connu trois saisons (on a cru d’ailleurs que la dernière en date ne verrait jamais le jour, suite à l’épidémie du Covid-19) et ne cesse d’être encensée par la critique et le public. Rarement, une œuvre française a démontré un tel degré de réalisme sur le sujet.
Et la distribution idoine est un atout supplémentaire. Outre Louise Bourgoin, extraordinaire dans son rôle de médecin taciturne, on retrouve le trio Alice Belaïdi, Zacharie Chasseriaud, Karim Leklou, excellent et surtout, à partir de la deuxième saison, le formidable Bouli Lanners (La Nuit du 12). Tous les ingrédients sont donc rassemblés pour qu’Hippocrate s’impose comme un Urgences hexagonal. Néanmoins, s’il existe des points communs entre les deux titres, Hippocrate se démarque suffisamment pour afficher une singulière identité. Par conséquent, il n’a point à rougir face à son homologue américain.

En immersion
Les amateurs d’Urgences se souviendront du pilote de la série, qui voyait John Carter découvrir l’univers singulier d’un hôpital de Chicago, de son service d’urgences et du rythme de travail trépidant imposé au personnel. Difficile de dire si Thomas Lilti a été influencé par son aîné américain, mais l’introduction d’Hippocrate s’en rapproche fortement. On y suit la jeune Alyson débarquer à l’institut Poincaré, au sein d’une équipe dégarnie de ses titulaires, en raison d’une possible contamination à un virus inconnu.
Une entrée en matière délicate pour la protagoniste, dépourvue de repères et qui va devoir s’atteler à une tâche à laquelle elle n’était pas préparée. De la théorie à la pratique du terrain, il y a un monde ou plutôt un fossé énorme dans lequel elle risque d’être engloutie à tout moment. Son premier contact avec les malades est éloquent, une personne âgée tout juste décédée avec toutes les contraintes administratives qui lui sont liées. Et l’absence de solidarité affichée par ses collègues, la force, de fait, à mûrir d’un coup.

On comprend alors que Thomas Lilti est là pour nous offrir un récit d’apprentissage tout en décortiquant un univers en pleine déliquescence, qui ne peut nous laisser indifférents puisqu’il s’agit de notre propre système de santé. Et à travers le périple de son héroïne et de ses compagnons d’infortune, il va entraîner le spectateur dans les tréfonds de l’administration, reposant uniquement sur le courage de quelques-uns. Et ce groupe hétéroclite se compose d’individus hauts en couleur, un poil cyniques, blasés ou au contraire perdus.
Parmi eux il y a Chloé qui fait figure de baroudeuse, Hugo, agneau encore couvé par une mère surprotectrice en charge du service de réanimation et enfin Arben, immigré albanais, cachant un secret inavouable. À partir de la deuxième saison, tout ce petit monde sera supervisé par le charismatique Olivier Brun (l’épatant Bouli Lanners). Thomas Lilti ne traite jamais ses personnages avec condescendance, sans pour autant excuser leurs erreurs et fait graviter autour d’eux quelques rôles secondaires fort bien écrits et par conséquent précieux. Ce travail minutieux permet de tous les ancrer avec justesse dans un dispositif narratif au diapason.
Accélération temporelle
Sur ce point, Hippocrate brille par sa maîtrise de la temporalité, qui se resserre au fil des épisodes. Néanmoins, Thomas Lilti refuse de s’adonner à la frénésie d’Urgences et préfère adopter un rythme lancinant alors que les minutes s’égrènent inexorablement dans cette antichambre de l’ultime espoir. Chaque saison s’étire sur une période de quelques jours, comme pour signifier que rien ne change vraiment si ce n’est la perception des personnages sur leur environnement, leur motivation et leurs sentiments les uns envers les autres.
Tandis qu’une semaine s’écoule à la vitesse de l’éclair, tout se suspend à la pointe d’un scalpel quand les interventions s’avèrent indispensables et que la pression s’accentue. Des instants interminables pendant lesquels les soignants grandissent un peu plus et font face à une adversité souvent invisible, entre les maux des souffrants et la désagrégation de leurs conditions de travail. Néanmoins, cela ne les empêche pas d’exaucer des miracles alors que le public retient son souffle et que l’horreur frappe, comme dans cette scène durant laquelle Olivier ordonne à Alyson d’introduire ses doigts dans le thorax d’un patient !

Et puis il y a le quatrième épisode de la saison 3, symbole du savoir-faire de Thomas Lilti ou plutôt accomplissement d’une entreprise titanesque, qui tient en haleine jusqu’au dernier plan. Un concentré de toutes les forces de la série, de sa puissance d’évocation, avec peu d’esbroufe et encore une fois beaucoup de recours à l’exercice temporel. Quand Arben, coincé dans un bâtiment de fortune et privé de moyens de communication, attend désespérément de l’aide, le créateur et son équipe insufflent un côté faussement épique, qui incarne un parfait contrepoids à Urgences et ses consorts.
Soignants et patients
Pour ceux qui l’ignoreraient, le serment d’Hippocrate impose à l’ordre médical de toujours prodiguer au mieux, les soins appropriés aux patients. En baptisant son œuvre avec le nom du célèbre praticien de l’antiquité, Thomas Lilti prédispose sa réflexion à étudier les relations si particulières qui lient la profession à ceux qu’elle se doit de protéger. Lors de la troisième saison, la direction de l’établissement Poincaré reproche avec insistance à ses membres d’éprouver de l’affection envers celles et ceux qu’ils traitent… une honte à laquelle Olivier Brun et les siens répondront avec force.
Alors que leurs supérieurs exigent vitesse de prise et charge et renvoi à domicile dans la foulée, les protagonistes s’attachent au fur et à mesure, quitte à commettre des erreurs ou à trop en faire, ce qui induit un coût élevé pour l’institut. Thomas Lilti se concentre sur la déshumanisation progressive de la médecine, l’ubérisation de la profession et la propension systémique à se préoccuper davantage de l’abattage et du rendement plutôt que de la qualité et du suivi sur le moyen terme. Voilà pourquoi Olivier, Alyson, Chloé, Arben et Hugo se battent pour tout changer, malgré les consignes, en dépit de la culpabilité passée.

Au-delà de leurs idéaux, la conscience prend le dessus et les tergiversations cessent. L’évolution d’Hugo s’avère éloquente à ce sujet, face à son impuissance à sauver une adolescente suicidaire. Celui qui fuyait ses responsabilités va petit à petit trouver ses repères, s’émanciper de sa mère et agir au mieux. On se polarise alors sur les portraits émouvants de quelques souffrants, d’une vieillarde démente aidant un Arben dépassé à cet homme requérant la présence de son chien ou d’un garçon intoxiqué qui ne désire pas mourir.
Au bord du gouffre
Quoi qu’il en soit, le véritable malade dans cette histoire, c’est bel et bien l’hôpital public, navire en berne que les acteurs peinent à maintenir à flot. Thomas Lilti dresse un terrible bilan tandis que ses protagonistes naviguent à vue et se battent pour préserver ce dernier bastion. Toutefois, le cinéaste préfère s’épancher sur les victimes plutôt que de désigner les coupables, invoquant cet ennemi invisible qui ronge les structures fragiles de Poincaré. La grogne du personnel s’amplifie, à l’image du début de révolte entamée par la chef des infirmières face à la résolution d’Olivier et des siens à continuer coûte que coûte.
Cette envie rejoint la ténacité de Chloé, Arben, Alyson et consorts dans une troisième saison où chacun est prêt à risquer sa carrière pour faire le nécessaire, y compris dans l’illégalité. L’initiation s’achève pour les uns et pour les autres, dans la douleur et les larmes plus que dans le sentiment du devoir accompli. Alyson se dispute ainsi avec son compagnon, arguant qu’elle avait tout connu dans cet endroit et ne pouvait de fait supporter sa lente, mais inexorable désagrégation. La fin de l’innocence en quelque sorte.
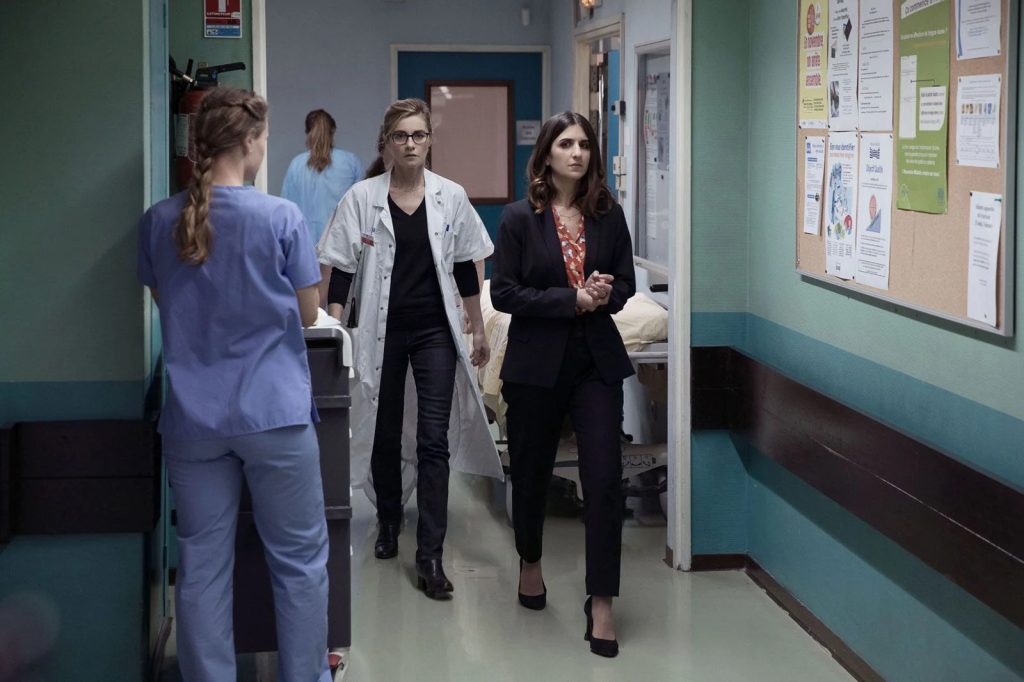
Et il y a le parcours d’Igor, figure tragique de la deuxième saison dont le destin funeste impacte les esprits et résume à lui seul la détresse de ces hommes et de ces femmes à bout de souffle. Quand la dernière étincelle d’espoir se dissipe, le vide s’ouvre et les engloutit. Le manque de communication, la surcharge émotionnelle ou l’accablement se confondent pour tout détruire. Ne subsistent plus que quelques mots inscrits sur un mur, dénués de l’humour d’antan.
La conclusion de la troisième saison annonce d’énormes bouleversements à venir et l’arrêt probable de deux des interprètes principaux. Il faut espérer que cela ne nuira pas à la qualité de l’ensemble, puisqu’indéniablement, Hippocrate appartient au cercle très fermé des meilleures séries télévisées françaises contemporaines et dont le souci du détail poussé à l’extrême la rend d’autant plus palpitante.
Série télévisée française de Thomas Lilti avec Louise Bourgoin, Alice Belaïdi, Zacharie Chasseriaud, Karim Leklou. 3 saisons. 22 épisodes. Disponible sur Canal +
François Verstraete
Share this content:

