Jeune femme devenue amnésique suite à un accident sur la route de Mullholand Drive, Rita fait la connaissance de Betty, une actrice qui rêve d’une carrière hollywoodienne. Sa quête pour recouvrer sa mémoire va la conduire au cœur d’un univers mystérieux… et horrifique !
Si le début du second millénaire a vu l’éclosion ou la confirmation d’une génération prometteuse menée par James Gray, Bong-Joon-Ho ou encore Abdelatif Kechiche, il a également assisté à l’apogée de deux cinéastes majeurs aux parcours diamétralement opposés. D’un côté se trouve la puissance du classicisme hollywoodien élevé au sommet par Clint Eastwood, enchaînant Mystic River, L’Échange, Lettres d’Iwo Jima et bien sûr Million Dollar Baby. Si ces longs-métrages pouvaient se targuer d’avoir conquis la décennie, nombre de spécialistes ont retenu une autre œuvre comme pierre angulaire, bien plus singulière, véritable ovni, marque de fabrique d’un auteur aux antipodes de Clint Eastwood. Ce film, c’est Mullholand Drive. Cet auteur, c’est David Lynch.
Avant de tourner Mulholand Drive, David Lynch ne s’est pas seulement imposé comme une figure majeure du septième contemporain, il a également révolutionné l’univers télévisuel avec Twin Peaks, qui a refaçonné la conception du média à l’aune des années quatre-vingt-dix. L’échec commercial de Twin peaks : Fire Walk with Me, prélude de la série sous forme de long-métrage, contraignit le réalisateur à abandonner l’idée de consacrer d’autres films à la célèbre Loge Noire, lieu cauchemardesque iconique de la série.

Pour la postérité
Cependant, Lynch rebondit en accouchant au fil du temps d’une trilogie qui affiche aussi bien une filiation thématique que diégétique à œuvre emblématique. Il y eut d’abord le poisseux et outrancier (confinant parfois à une maladresse grotesque) Lost Highway. Puis vint le temps de Mullholand Drive, somme de toutes les obsessions chères au metteur en scène et hommage en filigrane à tout un pan de l’Histoire du cinéma.
Lynch affectionne les films noirs, puisant son inspiration souvent dans l’un des genres phares du classicisme hollywoodien, mais n’hésitant pas à en remanier l’essence, à bifurquer vers le fantastique pour s’enfoncer un peu plus dans son univers onirique, fait de spectres et de démons à visage humain. Blue Velvet, Twin Peaks, Lost Highway voire Sailor et Lula, témoignent de cette démarche, parfois vacillante, généralement brillante.
Dans Blue Velvet, il ne craignit pas de citer allégrement Robert Aldrich et son En quatrième vitesse. Avec Mulholand Drive, il récidive s’appuyant sur le vénéneux polar de son aîné, pour dessiner les contours de son introduction. Reprenant le générique du long-métrage d’Aldrich, Lynch corrobore l’atmosphère purulente, sensuelle et sulfureuse qui en faisait l’éclat. Lynch jonche d’ores et déjà son œuvre de toute l’aura destructrice qui faisait la force du film d’Aldrich. Mais pas que…

En clair-obscur
Lynch, comme à son accoutumée, convie le spectateur et les protagonistes à entrer dans son univers fantasmagorique, à pénétrer le champ de l’inconscient, quitte à percer à jour les sombres secrets d’une existence oubliée, à faire passer chacun du rêve au cauchemar, du fantasme à la réalité. L’arrivée de Betty en ville n’échappe pas à cette règle. La découverte de la Cité des Anges, d’un appartement rupin, du monde hollywoodien nourrit bon nombre d’espoirs, mais aussi d’illusions.
À commencer quand elle invite Rita, inconnue amnésique, traquée par des forces qu’elle ne comprend pas. Lynch brouille les pistes d’un jeu de dupes digne d’un film noir… pour mieux surprendre par la suite. La boîte de Pandore clé de voûte chez Aldrich incarne une douloureuse madeleine de Proust, solution à une énigme imaginée par les puissances occultes. Le cinéaste multiplie les clins d’œil à sa série fétiche, comment ne pas penser à la Loge Noire, tant les références prolifèrent, si bien que l’amalgame fusionnel entre les différents mondes s’opère naturellement.

Chez Lynch, les ténèbres justement se nichent toujours en pleine lumière, et tapie dans l’ombre, la lumière parvient toujours à subsister. La lutte entre le bien et le mal fait rage, dévastant tout sur son passage, entraînant innocents, êtres cupides et coupables vers la folie, tous prisonniers d’un même cauchemar récurrent. Dans Mulholand Drive, comme l’évoque cet homme apeuré, il ne fait ni vraiment jour, ni réellement nuit, le monde est plongé dans un vaste purgatoire crépusculaire dans lequel anges et démons peuvent surgir à tout moment. Le moment où Winkie hurle de terreur, sera repris quinze ans plus tard par le cinéaste au cours de la conclusion de la saison 3 de Twin Peaks, quand Dale Cooper se confrontera au fléau ultime qui dévore l’univers de l’auteur.
Une forme éblouissante
En éclatant tous les repères temporels et en supprimant toute scène explicative, Lynch use des mêmes artifices présents dans Lost Highway. Pourtant, afin de ne pas répéter certaines erreurs, et quelque part ancrer son long-métrage dans une tragi-comédie peu subtile, le réalisateur va éviter de s’adonner à une violence frontale macabre et viscérale, pour plus de suggestion et d’immersion. Si bien que l’ambiance de terreur désirée par l’auteur n’a jamais été autant bien rendue dans toute son œuvre que dans Mulholand Drive, les dernières minutes n’ayant rien à envier à Carpenter ou à Tourneur.

Surtout, Lynch parvient à susciter l’émotion, l’empathie et l’antipathie aussi bien par des procédés coutumiers que par des champs d’expérimentation nouveaux pour lui. Ici, on s’apitoie ou s’agace face aux scènes d’humiliation, publique ou privée, tantôt amusantes lorsque le mari cocu découvre son épouse et son amant, tantôt déchirantes quand une femme voit sa compagne d’un jour partir définitivement dans les bras d’un autre, au cours d’une réception policée.
On s’ébahit envers l’objet de désir sexuel, convoitise absolue, d’abord chantre de fascination sensuel puis incarnation du désespoir. Enfin on se pâme devant les élans poétiques, témoignant d’une réelle maturité, bien plus encore que dans Twin Peaks. La séquence du cabaret nocturne portée par la voix d’une cantatrice prisonnière d’un geôlier invisible ou celle plus anodine d’un casting sans doute imaginaire, imprègne l’ensemble d’un sentiment d’épanouissement, celui d’un artiste en état de grâce.
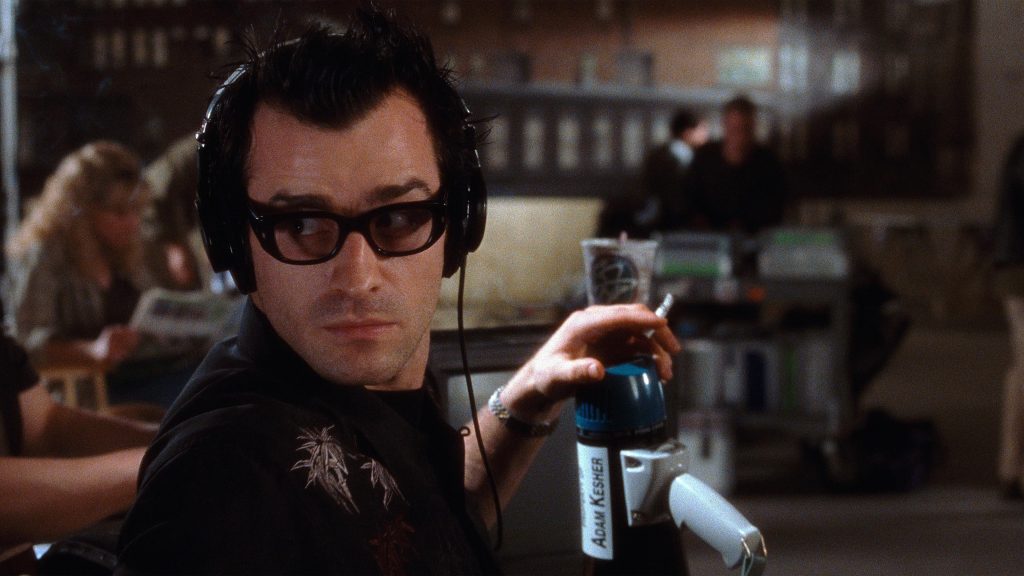
Les éléments s’assemblent alors peu à peu, et le puzzle insoluble se résout ; on voit, on contemple un ovni dans la lignée de 2001 ou Persona en leur temps. Puis, on comprend ou pense comprendre que le chaînon manquant réside dans les méandres du chef-d’œuvre de Bergman. La relation trouble, l’amour passionnel qui lie ces deux femmes, mais également la sensation qu’elles ne font qu’une rappelle inexorablement Persona. La structure si particulière de Mulholand Drive empêche un rapprochement immédiat, pourtant il ne fait aucun doute. C’est alors que derrière les atours du film noir, passé le couvert de l’épouvante, se drape une romance tragique qui vire au cauchemar, maudissant l’une et l’autre pour l’éternité.
Accomplissement, morceau d’anthologie inclassable, de fascination ou de dégoût, Mulholand Drive est tout cela à la fois et bien plus encore. Mécanique incomprise comme le furent les entreprises de Kubrick ou de Bergman à leur époque, le long-métrage de Lynch peut diviser, enchanter, mais en aucun cas laisser indifférent. Si le temps répond à la question sempiternelle de l’importance de l’homme au sein de son art, nul besoin d’attendre en revanche pour saisir celle de Mullholand Drive, sans doute l’œuvre la plus aboutie des années deux mille aux côtés de Million Dollar Baby.
Film américain de David Lynch avec Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux. Durée 2h26. 2001
François Verstraete
Share this content:

